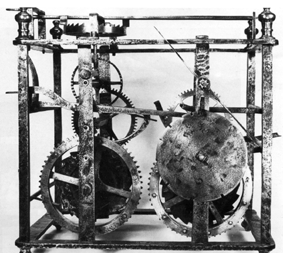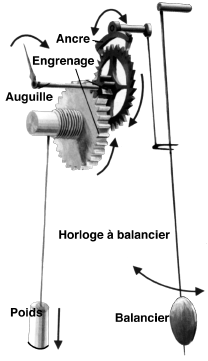HORLOGE
(or-lo-j'), s. f.
1°
Instrument destiné à marquer les heures.
Horloge solaire, cadran solaire. On disait aussi :
horloge au soleil.
2°
Instrument qui marque les heures à l'aide de
l'eau ou du sable.
Horloge de sable,
voy. SABLIER. Horloge d'eau, ou horloge à eau,
voy. CLEPSYDRE. Terme de marine. Sablier qui vide une
de ses bouteilles dans l'espace d'une demi-heure ; et,
par suite, l'espace d'une demi-heure.
3°
Machine destinée à marquer et à
sonner les heures, et servant à un usage
public. L'horloge du palais vint à frapper onze
heures, RÉGNIER, Sat. VIII. Quand les animaux
montrent dans leurs actions tant d'industrie, saint
Thomas a raison de les comparer à des horloges
et aux autres machines ingénieuses, BOSSUET
Connaiss. V, 2. Ou le temps qui s'enfuit une horloge
à la main, BOILEAU Art p. III. Le
présent que le calife Aaroun-al-Raschid fit
à Charlemagne d'une horloge sonnante fut
regardé comme une merveille, VOLT. Moeurs,
19.
Fig. Les
athées n'ont jamais répondu à
cette difficulté qu'une horloge [le
monde] prouve un horloger [Dieu], VOLT.
Lett. la Villevieille, 26 août 1768.
Monter, remonter
une horloge, en bander les ressorts ou en hausser les
poids.
Démonter une
horloge, en désassembler les
pièces.
Régler une
horloge, la mettre à l'heure d'après le
soleil.
Il est
réglé comme une horloge, c'est une
horloge, il est régulier dans ses
habitudes
Familièrement.
Une heure d'horloge, une heure complète,
mesurée sur une horloge, une grande heure. Je
vous ai attendu une heure d'horloge.
4°
Horloge marine, voy. MONTRE MARINE.
5°
Horloge de Flore, plantes rangées par ordre
et qui indiquent par leur ouverture et leur
clôture successives l'heure qu'il est. Les
convolvulus s'ouvrent le matin et se ferment le soir ;
les mauves ne s'ouvrent que vers les dix à onze
heures du matin : la belle de nuit, les
géranions tristes, etc. ne s'ouvrent que le
soir ; c'est ce qui a fait imaginer au Pline de la
Suède [Linné] son
ingénieuse horloge botanique, BONNET, Contempl.
nat. X, 31.
6°
Terme d'astronomie. Constellation
méridionale.
7°
Horloge de la mort, nom populaire d'un insecte
qui, rongeant le bois, fait entendre un bruit
semblable à celui du mouvement d'une montre, et
qui est un anobion (coléoptères),
particulièrement l'anobion marqueté,
nommé vrillette commune par certains auteurs
(LEGOARANT).
PROVERBES
:
C'est l'horloge du
palais, elle va comme il lui plaît.
Il demande quelle
heure il est quand l'horloge commence à sonner,
se dit d'un impatient.
Il n'est jamais
tard à son horloge, se dit d'un paresseux, d'un
homme lent à tout ce qu'il fait.
HISTORIQUE
:
XIIe s. E li
prophetes li respundi : Jo te frai demunstrance ; e il
i out uns oriloges par unt l'um veist cume l'ure del
jur veneit, e quant ele passeit, Rois, p.
17.
XIIIe s. Durement
furent esbahi Qu'il n'orent oï sonner cloche Ne
champenelle ne reloge, RUTEB. 315. Et refait sonner
ses orloges Par ses sales et par ses loges, à
roes trop sotivement De pardurable mouvement, la Rose,
21289. Ki velt faire le [la] maizon d'une
ierloge vesent [voient] ci une que jo vi une
fois, DE LABORDE, Émaux, p. 414.
XIVe s. Cestuy
maistre Jehan des orloges a fait de son temps grandes
oeuvres, entre lesquels oeuvres il a fait un
instrument, par aucuns appelé sphere, ou orloge
du mouvement du ciel : auquel instrument sont tous les
mouvements des signes et des planetes - et est faite
si soubtilement cette sphere que, nonobstant la
multitude des roes, qui ne se pourroient nombrer
bonnement sans defaire l'instrument, tout le mouvement
d'icelle est gouverné par un tout seul
contre-poids, DE LABORDE, Émaux, p. 414. Un
reloge d'argent tout entierement, sans fer, qui fut du
roy Phelippe le Bel avec deux contrepoix d'argent
emplis de plom, ID. ib. p. 415. Puis qu'ainsi la ville
me loge Sur ce pont pour servir d'auloge, Je feray les
heures ouïr Pour le commun peuple esjouir,
Inscription du gros horloge de Caen, 1314, dans LE
HÉRICHER, Hist. et gloss. du normand, II, p.
406. Pour faire sablon à mettre à
horloges, Ménagier, II, 5.
XVe s. Louis Carel,
maistre faiseur de mouvemens d'orloige, DE LABORDE,
Émaux, p. 416.
XVIe s. Le soir,
environ la troisieme horloge [demi-heure] du
second quart, le vent changea, J. PARMENTIER, Journ.
de voyage, dans JAL. ....à quoi ils ne
faillirent d'une seule minute d'horloge, DESPER. Cont.
CXXVIII. Il n'est horloge plus juste que le ventre,
COTGRAVE. Horloge entretenir, jeune femme à son
gré servir, vieille maison à
réparer, c'est toujours à recommencer,
LEROUX DE LINCY, Prov. t. II, p. 305. S'accorder comme
des horloges, ID. ib. p. 414.
ÉTYMOLOGIE
:
Berry, reloge,
r'loge, s. m. ; bourguig. reloge ; du lat. horologium,
qui vient du grec, heure, et, indication, (voy.
LOGIQUE).
SUPPLÉMENT
AU DICTIONNAIRE :
HORLOGE. Ajoutez :
- REM. Au XVIIe siècle on a dit quelquefois
horologe. Pour les jeux de hasard, Antoine Raffle on
nomme ; Pour faire une horologe, on nomme le Ralleur,
M. DE MAROLLES, le Livre des peintres, etc. Paris,
1865, p. 61.